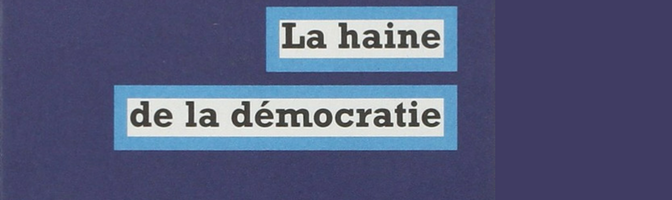Je reporte ici des extraits du livre « La haine de la démocratie », de Jacques Rancière, qui m’ont particulièrement intéressée. Cet essai est à retrouver aux éditions La fabrique, paru en 2005.
Ces extraits sont nécessairement sortis de leur contexte.
Quatrième de couverture
Hier encore, le discours officiel opposait les vertus de la démocratie à l’horreur totalitaire, tandis que les révolutionnaires récusaient ses apparences au nom d’une démocratie réelle à venir. Ces temps sont révolus. Alors même que certains gouvernements s’emploient à exporter la démocratie par la force des armes, notre intelligentsia n’en finit pas de déceler, dans tous les aspects de la vie publique et privée, les symptômes funestes de l’ « individualisme démocratique » et les ravages de l’ « égalitarisme » détruisant les valeurs collectives, forgeant un nouveau totalitarisme et conduisant l’humanité au suicide.
Pour comprendre cette mutation idéologique, il ne suffit pas de l’inscrire dans le présent du gouvernement mondial de la richesse. Il faut remonter au scandale premier que représente le « gouvernement du peuple » et saisir les liens complexes entre démocratie, politique, république et représentation. À ce prix, il est possible de retrouver, derrière les tièdes amours d’hier et les déchaînements haineux d’aujourd’hui, la puissance subversive toujours neuve te toujours menacée de l’idée démocratique.
Introduction
Rédaction de la constitution des États-Unis : préserver deux biens considérés comme synonymes : le gouvernement des meilleurs et la défense de l’ordre propriétaire.
Cette Amérique démocratique d’où nous viendrait tout le mal du respect des différences, du droit des minorités et de l’affirmative action sapant notre universalisme républicain.
Le gouvernement démocratique serait mauvais quand il se laisse corrompre par la société démocratique qui veut que tous soient égaux et toutes les différences respectées.
Finalement : il n’y aurait qu’une seule bonne démocratie, celle qui réprime la catastrophe de la civilisation démocratique.
De la démocratie victorieuse à la démocratie criminelle
Les protestations de ces idéalistes pour qui la démocratie est le gouvernement du peuple par lui-même et ne peut donc lui être amenée de l’extérieur par la force des armes.
C’est parce que la démocratie n’est pas l’idylle du gouvernement du peuple par lui-même, parce qu’elle est le désordre des passions avides de satisfaction, qu’elle peut et même doit être apportée de l’extérieur par les armes d’une superpuissance.
Le pouvoir de maîtriser le désordre démocratique.
Le bon gouvernement démocratique est celui qui est capable de maîtriser un mal qui s’appelle tout simplement la vie démocratique.
Ce qui provoque la crise du gouvernement démocratique n’est rien d’autre que l’intensité de la vie démocratique.
Sans doute le remède à cet excès de vitalité démocratique est-il connu : il consiste à orienter vers d’autres buts les énergies fiévreuses qui s’activent sur la scène publique, à la détourner vers la recherche de la prospérité matérielle, des bonheurs privés et des liens de société.
L’affrontement de la vitalité démocratique prenait ainsi la forme d’un double bind simple à résumer : ou bien la vie démocratique signifiait une large participation populaire à la discussion des affaires publiques, et c’était une mauvaise chose. Ou bien elle signifiait une forme de vie sociale tournant les énergies vers les satisfactions individuelles, et c’était aussi une mauvaise chose. La bonne démocratie devait être alors la forme de gouvernement et de vie sociale apte à maîtriser le double excès d’activité collective ou de retrait individuel inhérent à la vie démocratique.
Les propriétés qui étaient attribuées hier au totalitarisme, conçu comme État dévorant la société, sont tout simplement devenues les propriétés de la démocratie, conçue comme société dévorant l’État.
Ce qu’on énonçait naguère comme principe étatique de la totalité close est dénoncé maintenant comme principe social de l’illimitation.
Remettre la Terreur au cœur de la révolution démocratique [la Révolution française], c’était, au niveau le plus visible, casser l’opposition qui avait structuré l’opinion dominante. Totalitarisme et démocratie, enseignait François Furet, ne sont pas deux vrais opposés. Le règle de la terreur stalinienne était anticipé dans le règne de la terreur révolutionnaire. Or celle-ci n’était pas un dérapage de la Révolution, elle était consubstantielle à son projet ; elle était une nécessité inhérente à l’essence même de la révolution démocratique.
Classique opposition entre la démocratie parlementaire et libérale, fondée sur la restriction de l’État et la défense des libertés individuelles, et la démocratie radicale et égalitaire, sacrifiant les droits des individus à la religion du collectif et à la furie aveugle des foules.
La révolution est la conséquence e la pensée des Lumières et de son principe premier, la doctrine « protestante » élevant le jugement des individus isolés à la place des structures et des croyances collectives.
Brisant les vieilles solidarités qu’avaient lentement tissées monarchies, noblesse et Église, la révolution protestante a dissous le lien social et atomisé les individus.
Derrière la révérence aux Lumières et à la tradition anglo-américaine à la démocratie libérale et des droits de l’individu, on reconnaît la dénonciation très française de la révolution individualiste déchirant le corps social.
Hannah Arendt : les droits de l’homme sont une illusion car ils sont les droits de cet homme nu qui est sans droits. Ils sont les droits illusoires des hommes que des régimes tyranniques ont chassé de leurs maisons, de leurs pays et de toute citoyenneté.
Les droits de l’homme sont les droits des individus égoïstes de la société bourgeoise.
L’impatience de l’homme démocratique qui traite tout rapport sur un seul et même modèle : « les relations fondamentalement égalitaires qui s’établissent entre un prestataire de services et son client ». La bourgeoisie « a substitué aux nombreuses libertés si chèrement acquises l’unique et impitoyable liberté du commerce » : la seule égalité qu’elle connaisse est l’égalité marchande, laquelle repose sur l’exploitation brutale et éhontée, sur l’inégalité fondamentale du rapport entre le « prestataire » du service travail et le « client » achetant sa force de travail. Le texte modifié a substitué à « la bourgeoisie » un autre sujet, « l’homme démocratique ». À partir de là, il est possible de transformer le règne de l’exploitation en règne de l’égalité, et d’identifier sans plus de façons l’égalité démocratique à l’ « égal échange » de la prestation marchande. Le texte revu et corrigé de Marx nous dit en bref : l’égalité des droits de l’homme traduit l’ « égalité » du rapport d’exploitation qui est l’idéal achevé des rêves de l’homme démocratique.
Tocqueville entendait par « égalité des conditions » la fin des anciennes sociétés divisées en ordres et non le règne d’un individu avide de consommer toujours plus.
Avec le développement de la consommation de masse, la culture se trouvait dominée par une valeur suprême : la « réalisation de soi ». Cet hédonisme rompait avec la tradition puritaine qui avait soutenu conjointement l’essor de l’industrie capitaliste et de l’égalité politique. Les appétits sans restriction naissant de cette culture entraient en conflit direct avec les contraintes de l’effort productif comme avec les sacrifices nécessités par l’intérêt commun de la nation démocratique.
Jean Baudrillard dénonçait les illusions d’une « personnalisation » entièrement soumise aux exigences marchandes et voyait dans les promesses de la consommation la fausse égalité qui masquait « la démocratie absente et l’égalité introuvable ».
En transformant le consommateur aliéné d’hier en narcisse jouant librement avec les objets et les signes de l’univers marchand, la nouvelle sociologie du consommateur narcissique identifiait, elle, positivement démocratie et consommation. Du même coup, elle offrait complaisamment cette démocratie « réhabilitée » à une critique plus radicale. Réfuter la discordance entre individualisme de masse et gouvernement démocratique, c’était démontrer un mal bien plus profond.
Ainsi s’est opérée, dans un premier temps, la réduction de la démocratie à un état de société. Reste à comprendre le deuxième moment du processus, celui qui fait de la démocratie ainsi définie, non plus seulement un état social empiétant indûment sur la sphère politique mais une catastrophe anthropologique, une autodestruction de l’humanité.
Il s’agissait de savoir comment l’on devait entendre l’égalité à l’École ou par l’École.
La vision des élites savantes garantes des libertés dans un pays menacé par le despotisme inhérent au catholicisme.
Le concept d’ « élitisme républicain » permit de couvrir l’équivoque.
Au fil des dénonciations de l’inexorable montée de l’inculture liée au déferlement de la culture du supermarché, la racine du mal allait être identifiée : c’était bien-sûr l’individualisme démocratique. L’ennemi que l’École républicaine affrontait n’était plus alors la société inégale à laquelle elle devait arracher l’élève, c’était l’élève lui-même, qui devenait le représentant par excellence de l’homme démocratique, l’être immature, le jeune consommateur ivre d’égalité, dont les droits de l’homme était la charte.
La sanctification de l’individu, à travers les droits de l’homme et la démocratie.
Catastrophe civilisationnelle dont les noms synonymes sont consommation, égalité, démocratie ou immaturité.
« Hypermarché des styles de vie »
« Club-méditerranéisation du monde »
« Entrée de l’existence toute entière dans la sphère de la consommation »
« Emballement de la démocratie »
« Venin de la fraternité »
Mettre tous les phénomènes sur un seul et même plan en les rapportant tous à une seule et même cause.
La figure du consommateur démocratique ivre d’égalité pourra s’identifier selon l’humeur et les besoins de la cause au salarié revendicatif, au chômeur qui occupe les locaux de l’ANPE, ou à l’immigrant illégal refoulé dans les zones d’attente des aéroports.
La dénonciation de l « individualisme démocratique » opère en effet, à peu de frais, le recouvrement de deux thèses : la thèse classique des possédants (les pauvres en veulent toujours plus) et la thèse des élites raffinées : il y a trop d’individus, trop de gens qui prétendent au privilège de l’individualité. Le discours intellectuel dominant rejoint ainsi la pensée des élites censitaires et savantes du XIXè siècle : l’individualité est une bonne chose pour les élites, elle devient un désastre de la civilisation si tous y ont accès.
La théorie du double bind opposait le bon gouvernement démocratique au double excès de la vie politique démocratique et de l’individualisme de masse.
Le dénonciateur le plus radical du crime démocratique a été 20 ans auparavant le porte-drapeau de l’École républicaine et laïque.
République est, depuis Platon, le nom du gouvernement qui assure la reproduction du troupeau humain en le protégeant contre l’enflure de ses appétits de biens individuels ou de pouvoir collectif.
Gouvernement pastoral.
Pasteur divin qui s’occupe de toutes ses brebis et de chacune d’entre elles. Celui-ci s’est manifesté par une puissance qui manquera toujours à la parole démocratique, la puissance de la Voix, dont le chox, dans la nuit de feu, a été ressenti par tous les Hébreux, tandis qu’était donné au pasteur humain, Moïse, le soin exclusif d’en entendre et d’en expliciter les paroles, et d’organiser son peuple selon leur enseignement.
La politique ou le pasteur perdu
Le crime démocratique contre l’ordre de la filiation humaine est d’abord le crime politique, c’est-à-dire simplement l’organisation d’une communauté humaine sans lien avec Dieu le père.
À la démocratie, Platon fait 2 reproches. Elle est le règne de la loi abstraite, opposée à la sollicitude du médecin ou du pasteur. Les lois de la démocratie prétendent valoir pour tous les cas. Sous le citoyen universel de la constitution démocratique, il nous faut reconnaître l’homme réel, c’est-à-dire l’individu égoïste de la société démocratique.
La loi démocratique n’est ainsi pour lui que le bon plaisir du peuple, l’expression de la liberté d’individus qui ont pour seule loi les variations de leur humeur et de leur plaisir, indifférentes à tout ordre collectif.
Elle n’est pas seulement le règne des individus faisant tout à leur guise. Elle est proprement le renversement de toutes les relations qui structurent la société humaine : les gouvernants ont l’air de gouvernés, et les gouvernés de gouvernants ; les femmes sont les égales des hommes : le père s’accoutume à traiter son fils en égal ; le métèque et l’étranger deviennent les égaux du citoyen ; le maître craint et flatte les élèves qui, pour leur part, se moquent de lui ; les jeunes s’égalent aux vieux et les vieux imitent les jeunes ; les bêtes même sont libres et les chevaux et les ânes, conscients de leur liberté et de leur dignité, bousculent dans la rue ceux qui ne leur cèdent pas le passage.
La longue déploration des méfaits de l’individualisme de masse à l’heure des grandes surfaces et de la téléphonie mobile ne fait qu’ajouter quelques accessoires modernes à la fable platonicienne de l’indomptable âne démocratique.
Démocratie veut d’abord dire cela : un « gouvernement » anarchique, fondé sur rien d’autre que l’absence de tout titre à gouverner.
La démocratie n’est pas le bon plaisir des enfants, des esclaves ou des animaux. Elle est le bon plaisir de dieu, celui du hasard, soit d’une nature qui se ruine elle-même comme principe de légitimité. La démesure démocratique n’a rien à voir avec quelque folie consommatrice. Elle est simplement la perte de la mesure selon laquelle la nature donnait sa loi à l’artifice communautaire à travers les relations d’autorité qui structurent le corps social. Le scandale est celui d’un titre à gouverner entièrement disjoint de toute analogie avec ceux qui ordonnent les relations sociales, de toute analogie entre la convention humaine et l’ordre de la nature. C’est celui d’une supériorité fondée sur aucun autre principe que l’absence même de supériorité.
Le tirage au sort, nous disent-ils, convenait à ces temps anciens et à ces petites bourgades économiquement peu développées. Comment nos sociétés modernes faites de tant de rouages délicatement imbriqués pourraient-elles être gouvernées par des hommes choisis par le sort, ignorant la science de ces équilibres fragiles ? Nous avons trouvé pour la démocratie des principes et des moyens plus appropriés : la représentation du peuple souverain par ses élus, la symbiose entre l’élite des élus du peuple et l’élite de ceux que nos écoles ont formés à la connaissance du fonctionnement des sociétés.
Le tirage au sort était le remède à un mal à la fois bien plus grave et bien plus probable que le gouvernement des incompétents : le gouvernement d’une certaine compétence, celle des hommes habiles à prendre le pouvoir par la brigue.
Le tirage au sort n’a jamais favorisé les incompétents plus que les compétents.
Le procédé démocratique du tirage au sort est en accord avec le principe du pouvoir des savants sur un point, qui est essentiel : le bon gouvernement, c’est le gouvernement de ceux qui ne désirent pas gouverner. S’il y a une catégorie à exclure de la liste de ceux qui sont aptes à gouverner, c’est en tout cas ceux qui briguent pour obtenir le pouvoir.
Tel est le fond du problème. Il y a un ordre naturel des choses selon lequel les hommes assemblés sont gouvernés par ceux qui possèdent les titres à les gouverner. L’histoire a connu deux grands titres à gouverner les hommes : l’un qui tient à la filiation humaine ou divine, soit la supériorité dans la naissance ; l’autre qui tient à l’organisation des activités productrices et reproductrices de la société, soit le pouvoir de la richesse. Les sociétés sont habituellement gouvernées par une combinaison de ces deux puissances auxquelles force et science portent, en des proportions diverses, leur renfort. Mais si les anciens doivent gouverner non seulement les ignorants mais les riches et les pauvres, s’ils doivent se faire obéir des détenteurs de la force et comprendre des ignorants, il y a quelque chose de plus, un titre supplémentaire, commun à ceux qui possèdent tous ces titres mais aussi commun à ceux qui les possèdent et à ceux qui ne les possèdent pas. Or le seul qui reste, c’est le titre anarchique, le titre propre à ceux qui n’ont pas plus de titre à gouverner qu’à être gouvernés.
C’est cela d’abord que démocratie veut dire. La démocratie n’est ni un type de constitution, ni une forme de société. Le pouvoir du peuple n’est pas celui de la population réunie, de sa majorité ou des classes laborieuses. Il est simplement le pouvoir propre à ceux qui n’ont pas plus de titre à gouverner qu’à être gouvernés.
L’égalité n’est pas une fiction. Tout supérieur l’éprouve, au contraire, comme la plus banale des réalités. Pas de maître qui ne s’endorme et ne risque de laisser filer son esclave, pas d’homme qui ne soit capable d’en tuer un autre, pas de force qui s’impose sans avoir à se légitimer, à reconnaître donc, pour que l’inégalité puisse fonctionner, une égalité irréductible. Dès que l’obéissance doit passer par un principe de légitimité, qu’il doit y avoir des lois qui s’imposent en tant que lois et des institutions qui incarnent le commun de la communauté, le commandement doit supposer une égalité entre celui qui commande et celui qui est commandé.
La société inégalitaire ne peut fonctionner que grâce à une multitude de relations égalitaires.
Le pouvoir du peuple n’est pas celui de la population ou de sa majorité, mais le pouvoir de n’importe qui, l’indifférence des capacités à occuper les positions de gouvernant et de gouverné.
Démocratie, république, représentation
Il n’y a pas à proprement parler de gouvernement démocratique. Les gouvernements s’exerce toujours de la minorité sur la majorité. Le « pouvoir du peuple » est donc nécessairement hétérotopique à la société inégalitaire comme au gouvernement oligarchique.
La représentation n’a jamais été un système inventé pour pallier l’accroissement des populations. Elle n’est pas une forme d’adaptation de la démocratie aux temps modernes et aux vastes espaces. Elle est, de plein droit, une forme oligarchique, une représentation des minorités qui ont titre à s’occuper des affaires commune. Dans l’histoire de la représentation, ce sont toujours d’abord des états, des ordres, des possessions qui sont représentés, soit qu’ils soient considérés comme donnant titre à exercer le pouvoir, soit qu’un pouvoir souverain leur donne à l’occasion une voix consultative. Et l’élection n’est pas davantage en soi une forme démocratique par laquelle le peuple fait entendre sa voix. Elle est à l’origine l’expression d’un consentement qu’un pouvoir supérieur demande et qui n’est vraiment tel qu’à être unanime. L’évidence qui assimile la démocratie à la forme du gouvernement représentatif, issu de l’élection, est toute récente dans l’histoire. La représentation est dans son origine l’exact opposé de la démocratie. Nul ne l’ignore au temps des révolutions américaine et française. Les Pères fondateurs et nombre de leurs émules français y voient justement le moyen pour l’élite d’exercer en fait, au nom du peuple, le pouvoir qu’elle est obligée de lui reconnaître mais qu’il ne saurait exercer sans ruiner le principe même du gouvernement.
La « démocratie représentative » peut sembler aujourd’hui un pléonasme. Mais cela a d’abord été un oxymore.
Ce qu’on appelle « démocratie représentative » et qu’il est plus exact d’appeler système parlementaire ou, comme Raymond Aron, « régime constitutionnel pluraliste », est une forme mixte : une forme de fonctionnement de l’État, initialement fondée sur le privilège des élites « naturelles » et détournée peu à peu de sa fonction par les luttes démocratiques.
Le suffrage universel est une forme mixte, née de l’oligarchie, détournée par le combat démocratique et perpétuellement reconquise par l’oligarchie qui propose ses candidats et quelquefois ses décisions au choix du corps électoral sans jamais pouvoir exclure le risque que le corps électoral se comporte comme une population de tirage au sort.
La pratique spontanée de tout gouvernement tend à rétrécir cette sphère publique, à en faire son affaire privée et, pour cela, à rejeter du côté de la vie privée les interventions et les lieux d’intervention des acteurs non étatiques. La démocratie alors, bien loin d’être la forme de vie des individus voués à leur bonheur privé, est le processus de lutte contre cette privatisation, le processus d’élargissement de cette sphère. Élargir la sphère publique, cela ne veut pas dire, comme le prétend le discours dit libéral, demander l’empiètement croissant de l’État sur la société. Cela veut dire lutter contre la répartition du public et du privé qui assure une double domination de l’oligarchie dans l’État et dans la société.
Le « droit au travail », revendiqué par les mouvements ouvriers du XIXè siècle, signifiait d’abord cela : non pas la demande de l’assistance d’une « État-providence » à laquelle on a voulu l’assimiler, mais d’abord la constitution du travail comme structure de la vie collective arrachée au seul règne du droit des intérêts privés et imposant des limites au processus naturellement illimité de l’accroissement des richesses.
La distinction du public qui appartient à tous et du privé où règne la liberté de chacun. Mais cette liberté de chacun est la liberté, c’est-à-dire la domination, de ceux qui détiennent les pouvoirs immanents à la société. Elle est l’empire de la loi d’accroissement de la richesse. Quant à la sphère publique ainsi prétendument purifiée des intérêts privés, elle est aussi bien une sphère publique limitée, privatisée, réservée au jeu des institutions et au monopole de ceux qui les font marcher.
Le processus démocratique doit donc constamment remettre en jeu l’universel sous une forme polémique. Le processus démocratique est le processus de cette remise en jeu perpétuelle, de cette invention de formes de subjectivation et de cas de vérification qui contrarient la perpétuelle privatisation de la vie publique. La démocratie signifie bien, en ce sens, l’impureté de la politique, la récusation de la prétention des gouvernements à incarner un principe un de la vie publique et à circonscrire par là la compréhension et l’extension de cette vie publique. S’il y a une « illimitation » propre à la démocratie, c’est là qu’elle réside : non pas dans la multiplication exponentielle des besoins ou des désirs émanant des individus, mais dans le mouvement qui déplace sans cesse les limites du public et du privé, du politique et du social.
C’est ce déplacement inhérent à la politique elle-même que refuse l’idéologie dite républicaine. Celle-ci réclame la stricte délimitation des sphères du politique et du social, et identifie la république au règne de la loi, indifférente à toutes les particularités.
Équivoque caché dans la référence simple à une tradition républicaine de la séparation entre État et société.
La république est alors un régime d’homogénéité entre les institutions de l’État et les mœurs de la société. La tradition républicaine, en ce sens, ne remonte ni à Rousseau ni à Machiavel. Elle remonte proprement à la politeia platonicienne. Or celle-ci n’est pas le règne de l’égalité par la loi, de l’égalité « arithmétique » entre unités équivalentes. Elle est le règne de l’égalité géométrique qui met ceux qui valent plus au-dessus de ceux qui valent moins. Son principe n’est pa la loi écrite et semblable pour tous, mais l’éducation qui dote chacun et chaque classe de la vertu propre à sa place et sa fonction.
République et sociologie sont, en ce sens, les deux noms d’un même projet : restaurer par delà la déchirure démocratique un ordre politique qui soit homogène au mode de vie d’une société.
C’est ce que proposera la science sociologique moderne au lendemain de la Révolution française : remédier à la déchirure « protestante », individualiste, du tissu social ancien, organisé par le pouvoir de la naissance ; opposer à la dispersion démocratique la reconstitution d’un corps social bien distribué dans ses fonctions et hiérarchies naturelles et uni par des croyances communes.
La logique de la naissance et de la richesse produit une élite des « capacités » qui a le temps et les moyens de s’éclairer et d’imposer la mesure républicaine à l’anarchie démocratique.
La république naissante souscrit au programme sociologique : refaire un tissu social homogène qui succède, par delà la déchirure révolutionnaire et démocratique, au tissu ancien de la monarchie et de la religion. C’est pourquoi l’entrelacement de l’instruction et de l’éducation lui est essentiel.
Le mal absolu, c’est la confusion des milieux. Or la racine de cette confusion tient en un vice qui a deux noms équivalents, égalitarisme ou individualisme.
La « fausse démocratie », la démocratie « individualiste » conduit selon eux la civilisation à une avalanche de maux qu’Alfred Fouillée décrit en 1910, mais où le lecteur des journaux de l’an 2005 reconnaîtra sans peine les effets catastrophiques de Mai 1968, de la libération sexuelle et du règne de la consommation de masse :
« L’individualisme absolu, dont les socialistes mêmes adoptent souvent les principes, voudrait que les fils […] ne fussent en rien solidaires de leurs familles, qu’ils fussent chacun comme un individu X… tombé du ciel, bon à tout faire, n’ayant d’autres règles que les hasards de ses goûts. Tout ce qui peut rattacher les hommes entre eux semble une chaîne servile à la démocratie individualiste. Elle commence à se révolter même contre la différence des sexes et contre les obligations que cette différence entraîne : pourquoi élever les femmes autrement que les hommes, et à part, et pour des professions différentes ? Mettons-les tous ensemble au même régime et au même brouet scientifique, historique et géographique, aux mêmes exercices géométriques ; ouvrons à tous et à toutes également toutes les carrières […]. L’individu anonyme, insexuel, sans ancêtres, sans tradition, sans milieu, sans lien d’aucune sorte, voilà – Taine l’avait prévu – l’homme de la fausse démocratie, celui qui vote et dont la voix compte pour un, qu’il s’appelle Thiers, Gambetta, Taine, Pasteur, ou qu’il s’appelle Vacher. L’individu finira par rester seul avec son moi, à la place de tous les « esprits collectifs », à la place de tous les milieux professionnels qui avaient, à travers le temps, créé des liens de solidarité et maintenu des traditions d’honneur commun. Ce sera le triomphe de l’individualisme atomiste, c’est-à-dire de la force, du nombre et de la ruse. »
Que l’individualisme soit en telle défaveur auprès de gens qui déclarent par ailleurs leur profond dégoût pour le collectivisme et le totalitarisme est une énigme facile à résoudre. Ce n’est pas la collectivité en général que défend avec tant de passion le dénonciateur de l’ « individualisme démocratique ». C’est une certaine collectivité, la collectivité bien hiérarchisée des corps, des milieux et des « atmosphères » qui approprient les savoirs aux rangs sous la sage direction d’une élite. Et ce n’est pas l’individualisme qu’il rejette, mais la possibilité que n’importe qui en partage les prérogatives. La dénonciation de l’ « individualisme démocratique » est simplement la haine de l’égalité par laquelle une intelligentsia dominante se confirme qu’elle est bien l’élite qualifiée pour dirigée l’aveugle troupeau.
La république est l’idée d’un système d’institutions, de lois et de mœurs qui supprime l’excès démocratique en homogénéisant État et société. L’École, par laquelle l’État fait distribuer en même temps les éléments de la formation des hommes et des citoyens, s’offre tout naturellement comme l’institution propre à réaliser cette idée.
La distribution des savoirs n’a d’efficacité sociale que dans la mesure où elle est aussi une (re)distribution des positions.
Il n’y a pas de science de la juste mesure entre égalité et inégalité. Et il y en a moins que jamais quand le conflit éclate à nu entre l’illimitation capitaliste de la richesse et l’illimitation démocratique de la politique. La république voudrait être le gouvernement de l’égalité démocratique par la science de la juste proportion. Le gouvernement de la science est condamné à être le gouvernement des « élites naturelles » où le pouvoir social des compétences savantes se combine avec les pouvoirs sociaux de la naissance et de la richesse au prix de susciter à nouveau le désordre démocratique qui déplace la frontière du politique.
À gommer cette tension inhérente au projet républicain d’une homogénéité entre État et société, c’est en fait la politique elle-même que l’idéologie néo-républicaine efface. Sa défense de l’instruction publique et de la pureté politique revient alors à placer la politique dans la seule sphère étatique, quitte à demander aux gestionnaires de l’État de suivre les avis de l’élite éclairée. Les grandes proclamations républicaines du retour à la politique dans les années 1990 ont, pour l’essentiel, servi à soutenir les décisions des gouvernements, là même où elles signaient l’effacement du politique devant les exigences de l’illimitation mondiale du Capital, et à stigmatiser comme arriération « populiste » tout combat politique contre cet effacement. Restait alors à mettre, avec ingénuité ou cynisme, l’illimitation de la richesse au compte de l’appétit dévorant des individus démocratiques, et à faire de cette démocratie dévorante la grande catastrophe par laquelle l’humanité se détruit elle-même.
Les raisons d’une haine
Tout État est oligarchique. Le théoricien de l’opposition entre démocratie et totalitarisme en convient bien volontiers : « On ne peut pas concevoir de régime qui, en un sens, ne soit oligarchique » (Raymond Aron).
On peut énumérer les règles définissant le minimum permettant à un système représentatif de se déclarer démocratique. De telles règles n’ont rien d’extravagant, et, dans le passé, bien des penseurs ou des législateurs, peu portés à l’amour inconsidéré du peuple, les ont examinées avec attention comme des moyens d’assurer l’équilibre des pouvoirs, de dissocier la représentation de la volonté générale de celle des intérêts particuliers et d’éviter ce qu’ils considéraient comme le pire des gouvernements : le gouvernement de ceux qui aiment le pouvoir et sont adroits pour s’en emparer. Il suffit pourtant aujourd’hui de les énumérer pour susciter l’hilarité. À bon droit : ce que nous appelons démocratie est un fonctionnement étatique et gouvernemental exactement inverse, l’accaparement de la chose publique par une solide alliance de l’oligarchie étatique et de l’oligarchie économique.
Les maux dont souffrent nos « démocraties » sont d’abord les maux liés à l’insatiable appétit des oligarques.
Nous vivons dans des États de droit oligarchiques, c’est-à-dire dans des États où le pouvoir de l’oligarchie est limité par la double reconnaissance de la souveraineté populaire et des libertés individuelles. Ces libertés ne sont pas des dons des oligarques. Elles ont été gagnées par l’action démocratique et elles ne gardent leur effectivité que par cette action. Les « droits de l’homme et du citoyen » sont les droits de ceux qui leur donnent réalité.
La passion démocratique qui nuit si fort aux « candidats de gouvernement » n’est pas le caprice des consommateurs, c’est simplement le désir que la politique signifie quelque chose de plus que le choix entre oligarques substituables.
L’autorité de nos gouvernants est prise entre deux systèmes de raisons opposés ; elle est légitimée d’un côté par la vertu du choix populaire ; de l’autre, par leur capacité de choisir les bonnes solutions aux problèmes des sociétés. Or ces bonnes solutions se reconnaissent à ceci qu’elles n’ont pas à être choisies parce qu’elles découlent de la connaissance de l’état objectif des choses qui est affaire de savoir expert et non de choix populaire.
Pour tous les troubles du consensus, les oligarques, leurs savants et leurs idéologues ont trouvé l’explication : si la science n’arrive pas à imposer sa légitimité, c’est en raison de l’ignorance. Si le progrès ne progresse pas, c’est en raison des retardataires. Un mot, indéfiniment psalmodié par tous les clercs, résume cette explication : celui de « populisme ». Sous ce terme, on veut ranger toutes les formes de sécession par rapport au consensus dominant, qu’elles relèvent de l’affirmation démocratique ou des fanatismes raciaux ou religieux.
Populisme est le nom commode sous lequel se dissimule la contradiction exacerbée entre légitimité populaire et légitimité savante, la difficulté du gouvernement de la science à s’accommoder des manifestation de la démocratie et même de la forme mixte du système représentatif. Ce nom masque et révèle en même temps le grand souhait de l’oligarchie : gouverner sans peuple, c’est-à-dire sans division du peuple ; gouverner sans politique.
La guerre déclarée à l’ « État-providence » témoigne d’une même ambivalence. On la présente commodément comme la fin d’une situation d’assistance et le retour à la responsabilité des individus et aux initiatives de la société civile. On feint de prendre pour des dons abusifs d’un État paternel et tentaculaire des institutions de prévoyance et de solidarité nées des combats ouvriers et démocratiques et gérées ou cogérées par des représentants des cotisants. Et en luttant contre cet État mythique, on attaque précisément des institution de solidarité non étatiques qui étaient aussi les lieux de formation et d’exercice d’autres compétences, d’autres capacités à s’occuper du commun et de l’avenir commun que celles des élites gouvernementales. Le résultat en est le renforcement d’un État qui devient directement comptable de la santé et de la vie des individus.
La liquidation du prétendu État-providence n’est pas le retrait de l’État. Elle est la redistribution, entre la logique capitaliste de l’assurance et la gestion étatique directe, d’institutions et de fonctionnements qui s’interposaient entre les deux. L’opposition simpliste entre assistance étatique et initiative individuelle sert à masquer les deux enjeux politiques du processus et des conflits qu’il suscite : l’existence de formes d’organisation de la vie matérielle de la société qui échappent à la logique du profit ; et l’existence de lieux de discussion des intérêts collectifs qui échappent au monopole du gouvernement savant.
Le concept-roi qui anime cette dénonciation, celui du populisme, est emprunté à l’arsenal léniniste.
On reconnaît le grand argument de la réinterprétation de Mai 68, indéfiniment répété par les historiens et les sociologues, et illustré par les romanciers à succès : le mouvement de 68 n’a été qu’un mouvement de la jeunesse avide de libération sexuelle et de nouvelles matières à vivre. Comme la jeunesse et le désir de liberté, par définition, ne savent ni ce qu’ils veulent ni ce qu’ils font, ils ont produit le contraire de ce qu’ils déclaraient mais la vérité de ce qu’ils poursuivaient : la rénovation du capitalisme et la destruction de toutes les structures, familiales, scolaires ou autres qui s’opposaient au règne illimité du marché, pénétrant toujours plus profondément les reins et les cœurs des individus.
La nouvelle haine de la démocratie double la confusion consensuelle en faisant du mot « démocratie » un opérateur idéologique qui dépolitise les questions de la vie publique pour en faire des « phénomènes de société », tout en déniant les formes de domination qui structurent la société. Elle masque la domination des oligarchies étatiques en identifiant la démocratie à une forme de société et celle des oligarchies économiques en assimilant leur empire aux seuls appétits des « individus démocratiques ». Elle peut ainsi attribuer sans rire les phénomènes d’accentuation de l’inégalité au triomphe funeste et irréversible de l’ « égalité des conditions » et offrir à l’entreprise oligarchique son point d’honneur idéologique : il faut lutter contre la démocratie, parce que la démocratie c’est le totalitarisme.
Le pouvoir d’une assemblée d’hommes égaux ne pouvait être que la confusion d’une tourbe informe et criarde, qu’il était l’équivalent dans l’ordre social de ce qu’est le chaos dans l’ordre de la nature.
Le « gouvernement de n’importe qui » est voué à la haine interminable de tous ceux qui ont à présenter des titres au gouvernement des hommes : naissance, richesse, ou science.
La société inégale ne porte en son flan aucune société égale. La société égale n’est que l’ensemble des relations égalitaires qui se tracent ici et maintenant à travers des actes singuliers et précaires.